|
Metiers
d'antan

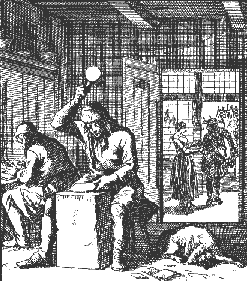
Batteur d'or
d'après Jan Luyken "Le livre des métiers"
1694
LES
ORFÈVRES, BATTEURS D'OR JOAILLIERS, LAPIDAIRES
(Extrait de Histoire anecdotique des métiers, paru en 1892.)
Les rapports constants de ces métiers entre eux permettent de les
réunir sous ce titre, et sans rechercher quels furent les premiers
en date, il est à croire que les ouvriers d'or précédèrent les autres
dans le chaos qui suivit la conquête franque.
Sous Dagobert, Éloi, avant de devenir ministre et évêque, avait travaillé
l'or. Moins de quatre cents ans après, Jean de Garlande,
parlant des ouvriers en métaux précieux dans son Dictionnaire, les subdivise en monnoyers,
fermailleurs, fabricants de
coupes et orfèvres au sens actuel du mot. Au temps de
Boileau, les orfèvres se sont un peu séparés de ces métiers divers.
Les lapidaires portaient alors le nom de cristalliers
ou pierriers dès le XIIIe
siècle ; ils taillaient les pierres précieuses et le cristal
de roche que les orfèvres montaient en or ou en argent. Les pierres
les plus répandues dans le commerce étaient les rubis, les émeraudes,
et en général toutes celles qui venaient d'Orient. Le béricle
était le cristal de roche qui ne pouvait, à cette époque, se confondre
avec le verre artificiel, mais déjà, la fabrication du faux
était à craindre pour les autres. On en était venu à une imitation
si parfaite des pierres naturelles orientales, que les lapidaires
ne les achetaient qu'avec le plus grand soin.
Il n'est pas rare de voir de nos jours certains reliquaires précieux
des XIIe et XIIIe
siècles ornés de cabochons faux, que d'ailleurs on mettait parfois
en parfaite connaissance de cause, mais que d'autres fois on avait
achetés sans y rien voir. « Aulcunes foys, dit le Propriétaire des
choses, cité par M. de Laborde dans son Glossaire, les faulses
pierres sont si semblables aux vraies que ceulx
qui myeulx si cognoissent y sont bien
souvent deceulz. »
|
Ces falsifications amenèrent des répressions et des règlements :
défenses furent faites de fabriquer à l'avenir « pierres de voirre, vouarre vers, esmeraudes de vouarre, rubis de vouarre, etc. ».
A part cela, pouvait être cristallier qui voulait bien, moyennant
qu'il eût de quoi répondre et qu'il sût
le métier. Le cristallier avait un apprenti auquel
il pouvait adjoindre ses fils. Les veuves de maîtres, réputées
incapables de montrer le métier aux apprentis, ne pouvaient
tenir boutique où l'on travaillât.
Les autres règlements étaient à peu près les mêmes que pour les
autres corps de métiers ; on ne pouvait tailler de nuit,
à peine de dix sols d'amende ; depuis les croisades de
saint Louis, en 1248, on payait la taille et le guet, « puis que le roi alla outre
mer. » L'ancien privilège ainsi aboli souleva bien des réclamations parmi
les intéressés ; ils firent valoir les droits fameux
des imagiers dont le « mestier
n'appartient fors à la honorance
de sainte eglise et ces haus hommes », mais ils ne furent point ouïs dans leurs plaintes.
|
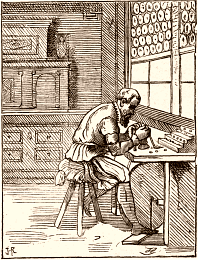
Joaillier-lapidaire au XVIe siècle,
d'après Jost Amman
|
Les orfèvres, eux, étaient plus importants. Ils travaillaient
les métaux précieux, à ce qu'on appelait la touche de Paris,
à cause de la pierre qui servait à la vérification. La touche
de Paris était le titre le plus estimé des ouvriers de ces temps.
Les statuts de Boileau, tout entiers faits pour les règlements d'administration
des corporations, ne nous laissent guère entrevoir la manière de
procéder des orfèvres et des cristalliers. Le plus souvent il faut
croire que les uns et les autres se joignaient dans un travail commun,
et que le cristallier préparait à l'orfèvre les pierres
que celui-ci enchâssait dans l'or. Cependant l'un et l'autre travaillaient
souvent à part, l'un pour tailler des coupes d'améthyste ou de cristal
de roche, l'autre pour tourner et repousser une coupe de métal.
L'orfèvre était libre au XIIIe
siècle ; il devait seulement se servir du bon or de Paris,
« lequel passe touz ors de quoi
en oevre en nulle terre ». L'argent devait avoir
la touche des esterlins. Parfois même on permettait à l'orfèvre
le travail de nuit pour le roi ou l'évêque de Paris. Chacun à son
tour ouvrait le dimanche et versait le produit de sa journée à la
caisse de la communauté ; cet argent servait à nourrir les
pauvres de l'Hôtel-Dieu. Les cristalliers, les batteurs d'or, et
ce que nous appellerions aujourd'hui les métiers de luxe, possédaient
tous cette caisse, qui n'avait qu'un emploi charitable.
Quoi qu'il en soit de la liberté de fabrication, les sanctions pénales
contre les délinquants ne laissaient pas que de comporter de lourdes
peines. Le prévôt pouvait bannir pour cinq ans les coupables.
|
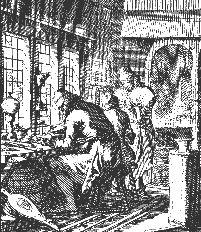
Orfèvre
d'après Jan Luyken "Le livre des métiers"
1694
|
Aux orfèvres et aux lapidaires-joailliers,
nous joindrons ici les batteurs d'or, qui préparaient le métal destiné
aux dorures de meubles et d'appartements et aux magnifiques manuscrits
que nous voyons encore aujourd'hui. A cette époque, les batteurs
d'or ne connaissaient pas le laminoir, et, s'il faut en croire le
moine Théophile, les feuilles s'obtenaient en les martelant entre
deux feuilles de parchemin poli et peint en rouge. Les batteurs
d'or étaient « membres des
orfèvres », selon ce qu'ils disaient eux-mêmes. Ces métiers subirent diverses
tribulations pendant le moyen âge à cause des guerres et de la rareté
du métal. Il n'était point rare que le roi empêchât tout à coup
la fabrication des pièces d'orfèvrerie, comme en 1310, par exemple,
où il fut défendu de fondre de la vaisselle pendant un an, à peine
de perdre tout.
L'année suivante, cédant aux remontrances des artisans, Philippe le
Bel dut revenir sur ces mesures, mais
avec modération, et seulement pour les objets destinés au culte.
Au XVe siècle, nouveaux empêchements également d'ordre
politique ; la fabrication en souffrit beaucoup, et ne se releva
guère qu'avec la Renaissance et le luxe du roi François.
Nous n'avons point à parler ici des célèbres orfèvres d'Italie du
XVe siècle, dont l'un eut l'insigne bonheur de
découvrir la gravure comme par surprise. Il faut lire dans le livre
de M. Duplessis, l'Histoire de la gravure, les lignes consacrées
à cette demi-légende. Quoi qu'il en soit,
le roi de France attira à sa cour les élèves de Maso Finiguerra
et ceux des autres artistes célèbres, dont le plus connu sinon le
plus méritant, Benvenuto Cellini, a donné lieu à tant de fables
et d'histoires apocryphes sur la foi de ses propres mémoires.
La vérité est que sous l'influence de ces artisans, l'orfèvrerie française,
de religieuse qu'elle était, devint païenne et mondaine. On n'apprécia
plus les objets au poids mais au travail. Alors les orfèvres sont
devenus autre chose que de simples batteurs de métaux, et l'un d'eux,
Étienne Delaulne, grava lui-même l'intérieur de sa boutique avec la
perfection d'un artiste de profession. Là était l'usurpation des
orfèvres sur les imagiers que nous constatons au chapitre de ces
derniers ; mais cette ingérence avait été si profitable qu'elle
avait créé un art qui devait briller d'un vif éclat chez nous, celui
de la taille-douce.
Sous Louis XIV, les orfèvres s'appliquèrent à l'ornementation des
meubles à l'allemande et bientôt ils se restreignirent à la joaillerie.
Quant à l'art des lapidaires, il s'est agrandi de toutes les découvertes
faites dans les pays orientaux. Le premier d'entre eux, Pierre de
Montarsy, amena la taille des pierres
à un degré qu'on n'a guère dépassé depuis.
Les graveurs en métaux d'abord confondus avec les orfèvres furent
bientôt séparés de la communauté et reçurent une vie propre en 1632.
Leurs statuts furent confirmés vingt-huit ans plus tard. Dès le
milieu du XVIIIe siècle leur nombre s'était accru, ils comptaient
alors près de 130 membres.

|